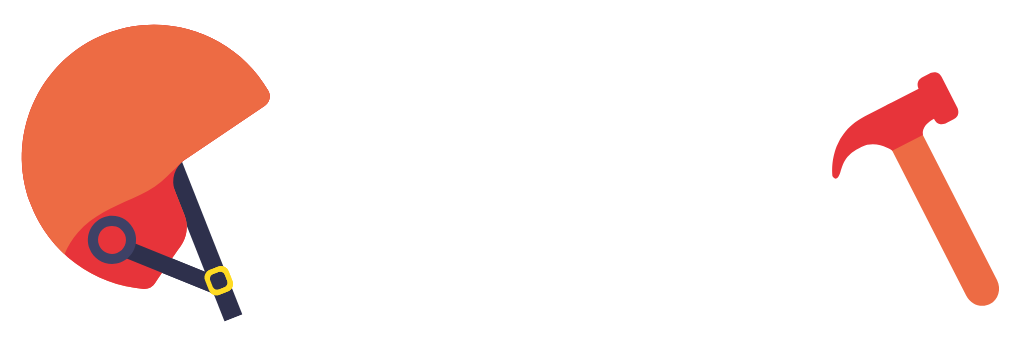“La voie de l’eau, j’ai bu la tasse. »

Par Gaïa
C’est bleu, très bleu, l’imagerie ultra saturée de cyan file un mal de crâne proche du post-noyade. L’usage agressif des effets spéciaux brutalisent l’œil et ne laisse aucune place à l’esprit, même si, on l’avait compris avec deux échanges d’onomatopées et l’étroite palette de vocabulaire qui caractérise les personnages que c’est pas le sujet ici.
La monochromie du film s’accorde néanmoins parfaitement avec son manichéisme crasse, les gentils schtroumpfs qui jouent à la sirène contre les méchants militaires, faire le mal n’est pas bien, profond.

Le scénario, non seulement creux mais de surcroît des plus crétins, ne laisse pas place au doute : A l’instar des faux-avatars militaires, qui gardent leur attirail de rangers pour mieux se fondre dans la masse, belle preuve d’honnêteté scénaristique, bien qu’intellectuellement insultant pour le public.
Ce film est néanmoins d’une formidable puissance culturelle, faisant des américains la civilisation la plus pointue en terme de torture mentale. Avec le motif aquatique récurrent, auquel on avait déjà eu droit avec le phénomène Baby Shark (je sais, c’est dur), les productions semblent décidées à noyer le public de stimulations, limitant ses capacités d’interactions avec l’art à le subir la projection. Le film vient littéralement au spectateur, la 3D à l’œuvre, les trois heures d’Avatar 2 agissent comme un enfermement mental dans la simplicité d’une représentation archaïque de cette société navii présentée comme idéale.
Les spectateurs constatant avec étonnement et effroi le vide abyssal de trois heures qui sépare le moment de leur entrée et sortie de la salle
En effet, au-delà de la médiocrité cinématographique du trop long métrage, l’enfumage sociétal qu’il porte relève de l’aberration. Promettant l’innovation, non-seulement d’un point de vue technique mais se voulant présenter une utopie bleue, le film ne fait qu’avancer une représentation anachronique et dépassée des rapports sociaux : les femmes à la cuisine (le feu de bois en l’occurrence) tandis que les vaillants mâles s’adonnent à la pratique guerrière, en bon défenseurs de la hiérarchie patriarcale de cette communauté chlorée. Madame Navii voit mari et fils partir au combat, s’entendant dire qu’il est nécessaire que la maison (la grotte ou la cahute pour ceux-là) soit tenue en leur absence. L’adolescente azuréenne, elle, oscille entre Martine-petite-maman et une petite sirène psychédélique complètement défoncée à se délecter des plaisirs abyssaux entre les “créatures” cameronnaises.
Effectivement, la formidable capacité d’innovation de James Cameron prend toute son ampleur dans le film : on ne dit plus baleine mais tulkun, innovation strictement langagière vous l’aurez compris.
La seule réussite de ce film, c’est de montrer le paradoxe de cette époque, comme quoi l’homme n’a jamais eu autant accès aux images et informations sur son milieu et il en demeure pourtant si déconnecté qu’il n’est capable que d’un émerveillement synthétique face à un monde qui ressemble pourtant en tout point au nôtre, atteignant le paroxysme de l’ironie lorsque la reproduction de l’eau à coups de pixels devient l’un des derniers arguments de vente du produit.
Un Tulkun (baleine inclusive)